Grand Prix du Concours Reine Elizabeth, 1983 : Pierre-Alain Volondat, 20 ans à peine, est projeté sur le devant de la scène. Pour la première fois dans l’histoire du concours, un lauréat emporte l’ensemble des distinctions. Après sa performance à l’occasion de la dixième édition du festival Haizebegi, il se confie.

— Qu’est-ce que cela signifie, pour vous, le piano ?
Pierre-Alain Volondat : Oh, c’est depuis longtemps. La première fois que j’en ai entendu, c’est le son, qui m’a beaucoup plu. C’est en même temps cristallin, d’une sensualité aussi… Bref : le son du piano me plaisait, c’est tout.
— Comment s’est faite votre initiation à l’instrument ?
Pierre-Alain Volondat : J’ai commencé le piano à l’âge de 7 ans, donc je ne peux pas être considéré comme un enfant prodige. J’avais une famille modeste, mes parents n’étaient pas musiciens. Je n’ai pas été poussé, et personne ne m’a repéré. En revanche, ma mère s’est battue jusqu’au bout pour que je devienne ce que je suis aujourd’hui. Je suis donc entré au conservatoire de Paris à 17 ans, j’en suis sorti à 19, et j’ai fait le concours Reine Elizabeth à 20 ans. Mais mon parcours a été très difficile. Ça n’a pas été un long fleuve tranquille, pour moi.
— Vous dîtes dans un documentaire qui vous est consacré : « Tout devient musique »… Qu’un bon professeur est avant tout un grand maître. Pour vous, c’est Vera Moore qui a assuré ce rôle ?…
Pierre-Alain Volondat : Tout à fait, oui, et je continue à le penser. C’est Vera Moore qui m’a préparé pour le concours Reine Elizabeth. Elle m’a fait travailler les traditions de Clara Schumann et de Beethoven, dont elle est héritière par plusieurs générations. Elle m’a aussi enseigné la dimension sculpturale du piano. Une interprétation, c’est à la note près, à l’intention près, c’est un travail absolument difficile. Il y en a qui veulent qu’on les appelle « maître », qui demandent parfois « savez-vous qui je suis ? ». Je leur réponds toujours sournoisement « non ». La maîtrise n’est pas un titre ou un grade, c’est un état. C’est un chemin d’angoisse, de trac, et c’est avant tout la maîtrise sur soi. On peut être maître un jour, et ne plus l’être le lendemain.
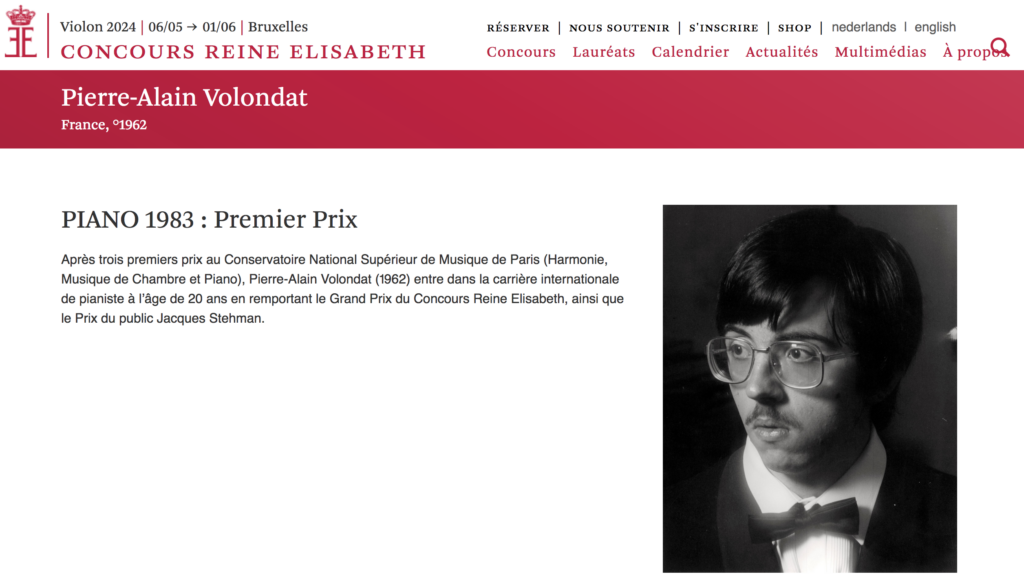
— Ce rôle de professeur, est-ce que vous l’avez également endossé ?
Pierre-Alain Volondat : Plus tard, oui ça m’est arrivé. Je suis d’ailleurs l’un des professeurs d’Alexandre Kantorow. Je l’ai préparé, entre autre, au deuxième concerto de Liszt. Je me souviens d’un cours de trois heures où on n’était toujours pas venu à bout du concerto, parce que j’avais tellement à dire, et que je ne l’ai pas lâché. C’est vrai qu’en l’entendant le jouer, il y a des idées où j’avais envie de dire « dis-donc, c’est à moi ça ! ». Mais ça n’est pas grave, c’est normal, et c’est la relève.
— Ce soir, vous avez interprété la Sonate en si mineur de Franz Liszt. Comment avez-vous choisi votre répertoire pour Haizebegi ?
Pierre-Alain Volondat : La sonate de Liszt, c’est Denis Laborde qui me l’a proposée. Ça devait faire vingt ans que je ne l’avais pas joué, donc je m’y suis remis. La grande difficulté, quand on joue à nouveau un morceau que l’on connaît déjà bien, c’est de faire table rase, et de le travailler comme si c’était la première fois qu’on l’entendait. Si je n’ai pas fait la carrière que j’aurais pu, c’est aussi parce que je n’ai jamais voulu être ligoté à des idées d’interprétations. Aujourd’hui, je suis complètement libre, et je pense que l’important, c’est d’aller aussi loin que possible, au bout de ses idées.
— Qu’est-ce qui fait une bonne interprétation ?
Pierre-Alain Volondat : C’est évidemment subjectif, et l’art, contrairement à la science, ne se juge pas avec des démonstrations et des théorèmes. Mais l’interprétation qui fonctionne, c’est celle dans laquelle le public est emporté. Elles peuvent être très différentes, mais c’est un courant qui passe, ou non. Si ça ne passe pas, c’est qu’il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Ou qui ne conviennent pas à la personne du musicien — il y a d’ailleurs des œuvres que je ne joue pas, parce que ça ne passe pas. Mais je pense que tous et toutes les artistes peuvent avoir des interprétations bonnes, et très différentes. Parfois, j’entends des morceaux, et je me dis « bon, pourquoi pas ? ». De toutes façons, les interprétations évoluent, comme le langage esthétique des écrivains. En écoutant d’anciens artistes, on se rend compte que l’on n’écrit plus comme ça, on ne joue plus comme ça. Tout cela change.

— Dans les années 1980, vous disiez savoir que vous aviez une mission à accomplir, et que vous ne sauriez mourir avant d’avoir fait le travail qui vous était imposé… Est-ce que vous pensez avoir atteint cet objectif ?
Pierre-Alain Volondat : C’est exact, mais je me sens un peu coupable d’avoir été présomptueux de ce côté-là. De quelle mission s’agissait-il, je n’en sais rien. Mais je crois que jusqu’à maintenant, c’était une mission de partage. C’est ce que beaucoup d’artistes oublient, à cause des chalands, de la pression médiatique. La substance de la musique, c’est l’esprit de partage. J’ai enregistré un peu, mais j’ai une préférence pour le live. Je pense qu’il faut savoir jouer comme un brave, comme quelqu’un qui n’a pas froid aux yeux. Il est question d’être vrai, dans l’instant et dans le moment. Dans l’enregistrement, on refait, on reprend. C’est différent.
Propos recueillis par Margot Artur de Lizarraga
L’enregistrement du concours Reine Élisabeth qui recueillit tous les suffrages



